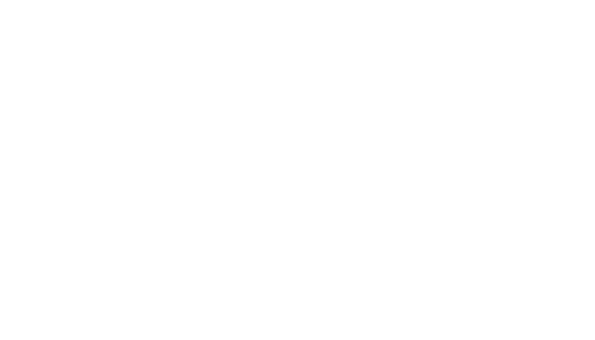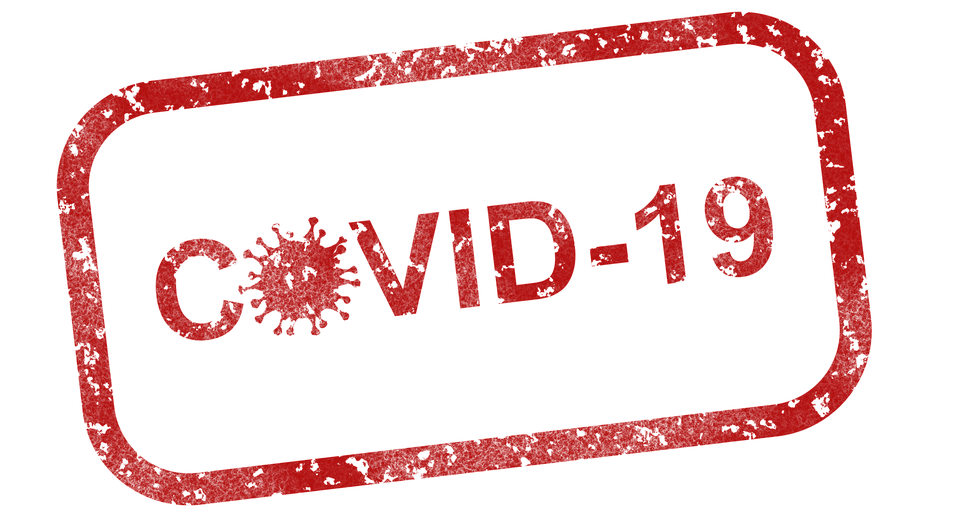
COVID-19 et force majeure
Depuis janvier 2020, l’épidémie de COVID-19 se propage, avec notamment l’existence d’une « première vague » en France entre les mois de mars et mai 2020, puis une « seconde vague » à compter du mois de septembre 2020. Cette épidémie a contraint le Gouvernement Français à prendre des mesures de restrictions exceptionnelles de fermeture jusqu’à nouvel ordre de tous les commerces et lieux dits « non essentiels » à la vie du pays tels que les restaurants, cafés, cinémas, discothèques ; des mesures d’interdiction des rassemblements et des déplacements sauf motifs dérogatoires ; des mesures de confinement des populations et de fermeture/contrôle des frontières du pays.
Depuis le 1er octobre 2016, la force majeure est définie à l’article 1218 du Code civil (alinéa 1) : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».
La définition d’un événement de force majeure posée par le Code civil, et les conséquences que cet événement emporte, ne sont pas d’ordre public, de sorte que les parties sont libres de compléter ou de modifier contractuellement les dispositions légales.
Le régime de la force majeure prévu par le Code civil (article 1218 al.2) prévoit que : « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
Pour établir si l’épidémie de COVID-19 constitue un cas de force majeure, il convient donc de vérifier, au cas par cas, si celle-ci constitue un événement imprévisible et irrésistible pour les parties, eu égard à la nature des prestations contractuelles. Le caractère incontrôlable (pour les cocontractants) de l’épidémie ne fait ici pas débat.
Certaines juridictions ont d’ores et déjà qualifié la crise du COVID-19 de cas de force majeure (v. not. Cour d’appel de Bordeaux, 19 mars 2020, n°20/01424, Cour d’appel de Colmar, 12 mars 2020, n°20/01098, statuant en matière de contentieux de liberté et détention et T. com. Paris, ord. réf., 20 mai 2020, n° 2020-16407, confirmé par la Cour d’appel de Paris, 28 Juillet 2020 – n° 20/06689).
En pratique, s’agissant de l’imprévisibilité de l’épidémie, celle-ci devrait être considérée comme acquise pour les contrats conclus avant le début de l’année 2020, rien ne laissant présager à cette époque de l’ampleur de la crise. A l’inverse, pour les contrats conclus depuis le début de l’année 2020, et a fortiori depuis le mois de mars 2020, il est probable que l’épidémie de COVID-19 ne soit pas considérée comme un cas de force majeure car l’imprévisibilité s’apprécie au jour de la conclusion du contrat[1].
S’agissant de irréversibilité de événement, la date à laquelle la crise est devenue « irrésistible » pour chacun des prestataires variera selon la nature de la prestation convenue entre les parties et l’effet sur ces prestations des différentes mesures gouvernementales d’interdiction.
*****
N’hésitez pas à contacter directement notre cabinet, qui pourra vous conseiller utilement sur la mise en œuvre des dispositions précitées.
[1] Par exemple, s’agissant de l’épidémie de chikungunya en 2006, les tribunaux ont considéré que « l’épidémie de chikungunya a débuté en janvier 2006 et ne peut être retenue comme un événement imprévisible justifiant la rupture du contrat en août suivant après une embauche du 4 juin. […] Ainsi, dans les faits, la force majeure alléguée fait défaut » (Saint-Denis de la Réunion, 29 déc. 2009, n° 08/02114).

Synergie des compétences au sein d’une SPE
Une SPE c’est quoi ?
Instituées par la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015, dite loi Macron, les sociétés pluriprofessionnelles d’exercice (SPE) autorisent l’exercice de la profession d’avocat et de Conseils en Propriété industrielle au sein d’une même structure.
Aujourd’hui, seules quelques SPE regroupant des CPI et des avocats ont été créées, essentiellement à Paris. ROMAN-ANDRÉ est la première SPE de ce type à Marseille et dans la région Sud.
Pourquoi exercer en SPE ?
ROMAN-ANDRÉ est issu de la fusion de deux acteurs historiques de la propriété intellectuelle à Marseille : le cabinet ROMAN (cabinet de CPI créée en 1892) et le cabinet Bonnaffons X André (avocats spécialisés en contentieux du droit de la propriété intellectuelle depuis 1975).
Pour simplifier le propos, les CPI gèrent essentiellement la partie « administrative » des titres de propriété industrielle (PI), en vue de leur délivrance par les offices concernés. Les avocats gèrent essentiellement le contentieux « judiciaires » de ces mêmes titres de PI devant les tribunaux.
Nous avons choisi d’exercer en SPE pour développer une structure à guichet unique (un seul point d’entrée) capable d’offrir à nos clients un accompagnement global en matière de propriété intellectuelle, du dépôt des titres PI (brevets, marques, dessins et modèles) à leur défense devant les offices administratifs et les tribunaux. C’est une offre complète de services, du dépôt au litige, en passant par le financement et la rédaction de contrats.
Nous sommes particulièrement sensibles au monopôle que confère un titre PI et sommes convaincus que la valeur principale d’un titre PI dépend de sa capacité à être imposé et défendu dans le cadre d’un litige, d’un audit, d’une évaluation, d’une négociation de licence ou de cession.
Aussi, une bonne maîtrise du contentieux permet de mieux rédiger un brevet, de mieux déposer une marque ou un dessin & modèle. Parallèlement, cette qualité des titres déposés et la maîtrise des procédures administratives permettent de mieux aborder les phases pré-contentieuses et contentieuses. C’est un cercle vertueux dans lequel s’inscrit la SPE.
Cette approche « offensive » du droit de la propriété intellectuelle constitue pour ainsi dire notre ADN, ce qui d’une part est apprécié par les clients, et d’autre part, nous distingue de nos concurrents.