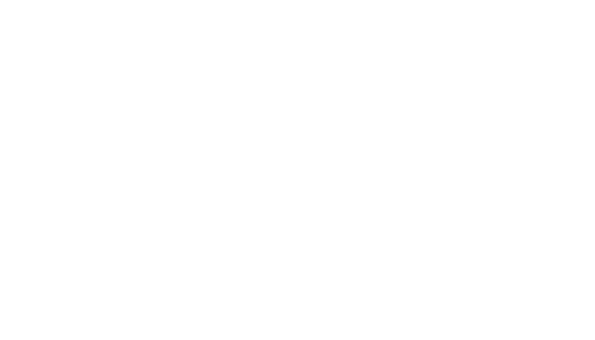La demande d’enregistrement d’un signe à titre de marque ne constitue pas un acte de contrefaçon
Dans un arrêt du 13 octobre 2021, la Cour de cassation s’aligne sur celle de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).
Jusqu’à cet arrêt, le dépôt à titre de marque d’un signe contrefaisant pouvait être considéré comme un acte de contrefaçon, indépendamment de son exploitation.
Par attendu bienvenu, la Cour de cassation indique que : « la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque, même lorsqu’elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services, au sens de la jurisprudence de la CJUE, en l’absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe. De même, en pareil cas, aucun risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, aucune atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque, ne sont susceptibles de se produire ».
Ainsi, à défaut de commercialisation des produits et services, le seul dépôt d’une marque, suivi ou non de son enregistrement, ne constitue pas un acte de contrefaçon.
Cet arrêt aura notamment un impact en matière contentieuse dans la mesure où ce type de litiges devra maintenant être porté devant l’INPI, par le biais d’oppositions ou d’action en nullités, et non plus devant les tribunaux judiciaires.
Notre équipe d’avocat et de CPI se tient à votre disposition pour gérer ce type de litiges.

Roman-André a été récompensé par le Palmarès du droit
Roman-André est fier d’avoir été distingué à l’occasion du Palmarès du Monde du Droit, à Marseille, le mois dernier.
Suite à la création de la SPE en janvier 2020, née de la fusion entre Alexis Roman CPI et Me Jean André, le cabinet Roman-André a concouru pour la première fois au prestigieux palmarès.
Roman-André a gagné 2 prix :
Trophée d’Or du meilleur conseil en Propriété intellectuelle
Trophée d’Argent du meilleur cabinet d’avocat en Brevet, Marques, TIC
Deux trophées que le cabinet dédie à leurs équipes pour leur engagement et à leurs clients pour leur confiance.
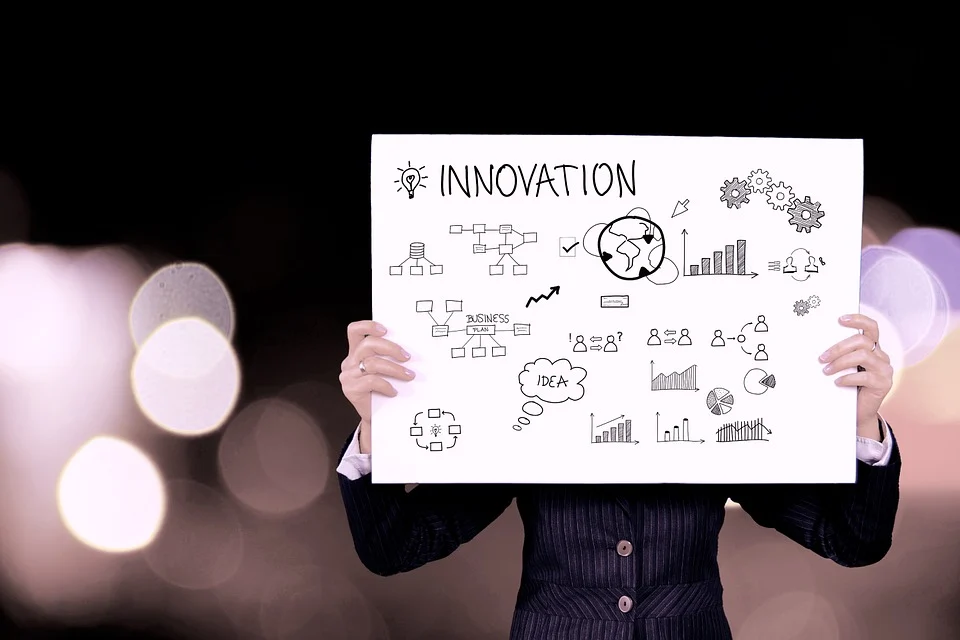
Sécuriser et protéger les créations et innovations d’une entreprise en quelques étapes
1. Identifier les créations/innovations
Innovations techniques, innovations non techniques, créations artistiques.
2. S’assurer qu’une création/innovation appartienne à l’entreprise
Règle générale : la création/innovation appartient à la personne physique qui en est l’auteur/inventeur
Exception : Invention de mission (brevet) ou logiciel réalisé par un salarié
→ La cession des droits par voie contractuelle doit être privilégiée.
3. Protéger la création/innovation
– Par le dépôt d’un titre de propriété industrielle(brevet, marque, dessin&modèle)
– Par la date de création(droit d’auteur)
– Par la mise au secret:
Identifier les informations devant être mises au secret
Formaliser et/ou s’en ménager la preuve (ex : enveloppe Soleau)
Mentionner le caractère secret dans ses offres et autres documents
Signer des accords de confidentialité (NDA)
N’hésitez pas à contacter le cabinet afin d’obtenir plus d’informations sur la sécurisation et la protection des créations et innovations de votre entreprise.

La surveillance de Marques : intérêts et solutions
Si le dépôt de la marque permet de constituer un monopole, la surveillance est l’outil indispensable pour le maintenir.
En effet, votre marque est le signe à travers lequel vos clients vont identifier votre activité et vous distinguer de vos concurrents. Elle représente votre identité, vos valeurs et votre image.
Afin que vous puissiez bénéficier pleinement du monopole conféré par la marque, il est nécessaire de la protéger et de la défendre en mettant en place une surveillance sur celle-ci.
- Quels intérêts ?
Contrairement à ce que pensent de nombreux déposants, il n’appartient pas à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) de vérifier si une marque est disponible. Il est donc tout à fait possible que l’INPI accepte d’enregistrer une marque déjà déposée, sans que le titulaire des droits antérieurs n’en soit informé.
Il appartient donc aux titulaires de s’assurer que les tiers ne portent pas atteinte à leurs droits en surveillant leurs marques.
La surveillance est d’autant plus stratégique et importante qu’elle permet d’identifier rapidement les dépôts gênants effectués par des tiers afin de mieux s’y opposer, le cas échéant, sans avoir à engager les frais d’une action judiciaire. En effet, certaines procédures administratives, rapides et peu coûteuses, existent pour défendre vos droits mais elles sont enfermées dans un délai très court (par exemple, le délai d’opposition est de 2 mois en France).
On ajoutera que le titulaire d’une demande de marque sera plus enclin à la retirer en amont de son projet, lorsque les investissements de communication autour de la marque n’ont pas encore été engagés.
- Quels risques ?
Le titulaire qui ne surveillerait pas activement sa marque s’expose à une dilution de son monopole en laissant des tiers, potentiellement concurrents, copier ou imiter son signe distinctif lui permettant de rallier sa clientèle.
Par ailleurs, le droit prévoit que le titulaire d’une marque qui aurait toléré pendant cinq ans l’usage d’une marque postérieure est irrecevable à agir. C’est ce que l’on appelle la forclusion par tolérance.
Il est donc nécessaire que le titulaire soit réactif et opère une surveillance active de ses marques pour agir efficacement contre les dépôts susceptibles de le gêner.
- Quelles solutions pour surveiller sa marque ?
Chez Roman-André, nous proposons la mise en place d’une stratégie de surveillance personnalisée. Nous adaptons notre proposition de surveillance en fonction de vos territoires d’intérêt (France, Union européenne, Europe géographique, monde entier, etc.) et des droits que vous souhaitez cibler (marques, dénominations sociales et/ou noms de domaine).
Dans le cadre de cette prestation, nous analysons quotidiennement les nouveaux dépôts afin d’identifier et de vous signaler ceux qui seraient susceptibles de vous gêner. Dans l’hypothèse où vous souhaiteriez agir, nous analysons les chances de succès et vous conseillons sur les moyens d’action les mieux adaptés pour défendre vos droits.
N’hésitez pas à contacter le Département Marques du cabinet afin d’obtenir plus d’informations concernant la surveillance de marques.

L’importance des droits de propriété intellectuelle pour la performance des entreprises
L’Office européen des brevets (OEB) et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ont publié le lundi 8 février 2021 une étude portant sur le lien entre la possession de droits de propriété intellectuelle (DPI) et la performance des entreprises dans l’Union européenne.
Les résultats de cette étude sont éloquents : les entreprises qui détiennent au moins un DPI génèrent en moyenne un chiffre d’affaires supérieur de 20% à celui réalisé par les entreprises qui n’en possèdent aucun. Ces mêmes entreprises versent par ailleurs des rémunérations en moyenne 19% plus élevées que les autres entreprises.
Selon le président de l’OEB : « Plus votre portefeuille de DPI est solide, plus votre entreprise est performante. Et les entreprises détentrices de DPI ne se contentent pas de générer un chiffre d’affaires supérieur, leurs employés en bénéficient aussi. Ce sont là des enseignements importants pour notre économie et notre société. L’étude dévoile également qu’il existe un important potentiel inexploité pour les PME en Europe, car elle montre qu’elles sont les plus susceptibles de tirer profit de la propriété intellectuelle. De plus, les entreprises qui ont un recours intensif aux DPI sont celles qui ont contribué à nous sortir de la crise financière de 2008. Je suis donc convaincu que l’innovation contribuera à la relance de l’Europe après le COVID-19 ».
L’étude publiée par les Offices européens révèle également une forte disparité selon la taille de l’entreprise concernée : seules 9% des PME possèdent au moins l’un des trois types de DPI (marques, brevets, dessins et modèles), contre près de six grandes entreprises sur dix. Ces chiffres progressent peu d’année en année, alors qu’ils sont exponentiels en Chine.
Selon Yann Ménière, économiste en chef de l’OEB : « Beaucoup de patrons de PME ne sont pas conscients que mieux exploiter leurs actifs immatériels ouvre des possibilités de développement ».
De plus, il apparait que les PME qui combinent différents DPI génèrent un chiffre d’affaires par employé encore plus élevé. Soit 75% de plus pour les PME qui détiennent des brevets et des marques, 84% de plus pour les PME qui détiennent des marques et des dessins et modèles, et 98% supplémentaires pour celles qui possèdent chacun des trois types, par rapport aux entreprises qui ne possèdent aucun de ces DPI.
Outre les DPI visés dans cette étude, il convient également de noter que le savoir-faire peut faire l’objet d’une protection spécifique en France, notamment grâce à la loi du 30 juillet 2018 sur la protection du secret des affaires. Cette protection suppose également d’être organisée juridiquement.
Chez Roman André, nous sommes persuadés que « le monde d’après » se prépare par l’innovation, notamment en matière de santé et de développement durable, mais aussi par le design et la transmission des savoir-faire ancestraux.
C’est pourquoi nous mettons toute notre expertise en matière de propriété intellectuelle à votre service, pour protéger vos innovations, vos connaissances, les défendre, les valoriser et les transmettre.
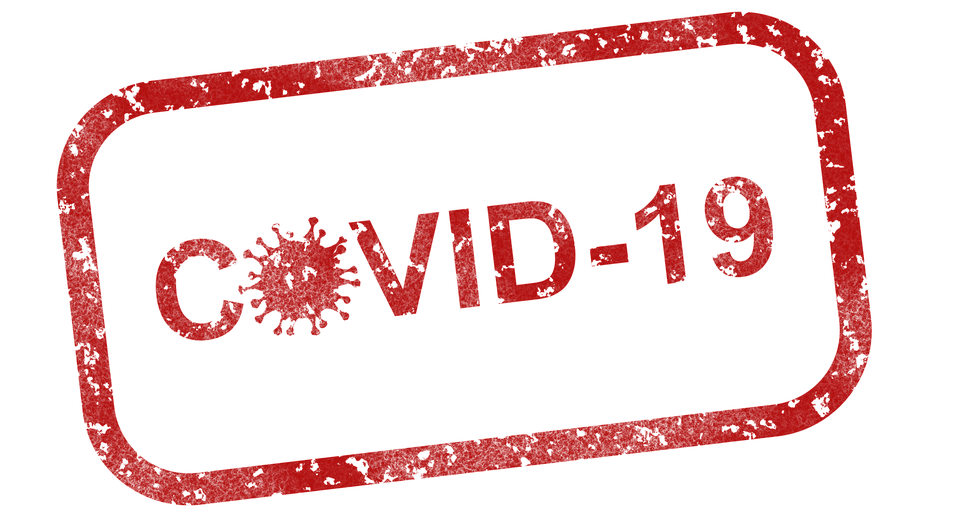
COVID-19 et force majeure
Depuis janvier 2020, l’épidémie de COVID-19 se propage, avec notamment l’existence d’une « première vague » en France entre les mois de mars et mai 2020, puis une « seconde vague » à compter du mois de septembre 2020. Cette épidémie a contraint le Gouvernement Français à prendre des mesures de restrictions exceptionnelles de fermeture jusqu’à nouvel ordre de tous les commerces et lieux dits « non essentiels » à la vie du pays tels que les restaurants, cafés, cinémas, discothèques ; des mesures d’interdiction des rassemblements et des déplacements sauf motifs dérogatoires ; des mesures de confinement des populations et de fermeture/contrôle des frontières du pays.
Depuis le 1er octobre 2016, la force majeure est définie à l’article 1218 du Code civil (alinéa 1) : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».
La définition d’un événement de force majeure posée par le Code civil, et les conséquences que cet événement emporte, ne sont pas d’ordre public, de sorte que les parties sont libres de compléter ou de modifier contractuellement les dispositions légales.
Le régime de la force majeure prévu par le Code civil (article 1218 al.2) prévoit que : « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
Pour établir si l’épidémie de COVID-19 constitue un cas de force majeure, il convient donc de vérifier, au cas par cas, si celle-ci constitue un événement imprévisible et irrésistible pour les parties, eu égard à la nature des prestations contractuelles. Le caractère incontrôlable (pour les cocontractants) de l’épidémie ne fait ici pas débat.
Certaines juridictions ont d’ores et déjà qualifié la crise du COVID-19 de cas de force majeure (v. not. Cour d’appel de Bordeaux, 19 mars 2020, n°20/01424, Cour d’appel de Colmar, 12 mars 2020, n°20/01098, statuant en matière de contentieux de liberté et détention et T. com. Paris, ord. réf., 20 mai 2020, n° 2020-16407, confirmé par la Cour d’appel de Paris, 28 Juillet 2020 – n° 20/06689).
En pratique, s’agissant de l’imprévisibilité de l’épidémie, celle-ci devrait être considérée comme acquise pour les contrats conclus avant le début de l’année 2020, rien ne laissant présager à cette époque de l’ampleur de la crise. A l’inverse, pour les contrats conclus depuis le début de l’année 2020, et a fortiori depuis le mois de mars 2020, il est probable que l’épidémie de COVID-19 ne soit pas considérée comme un cas de force majeure car l’imprévisibilité s’apprécie au jour de la conclusion du contrat[1].
S’agissant de irréversibilité de événement, la date à laquelle la crise est devenue « irrésistible » pour chacun des prestataires variera selon la nature de la prestation convenue entre les parties et l’effet sur ces prestations des différentes mesures gouvernementales d’interdiction.
*****
N’hésitez pas à contacter directement notre cabinet, qui pourra vous conseiller utilement sur la mise en œuvre des dispositions précitées.
[1] Par exemple, s’agissant de l’épidémie de chikungunya en 2006, les tribunaux ont considéré que « l’épidémie de chikungunya a débuté en janvier 2006 et ne peut être retenue comme un événement imprévisible justifiant la rupture du contrat en août suivant après une embauche du 4 juin. […] Ainsi, dans les faits, la force majeure alléguée fait défaut » (Saint-Denis de la Réunion, 29 déc. 2009, n° 08/02114).